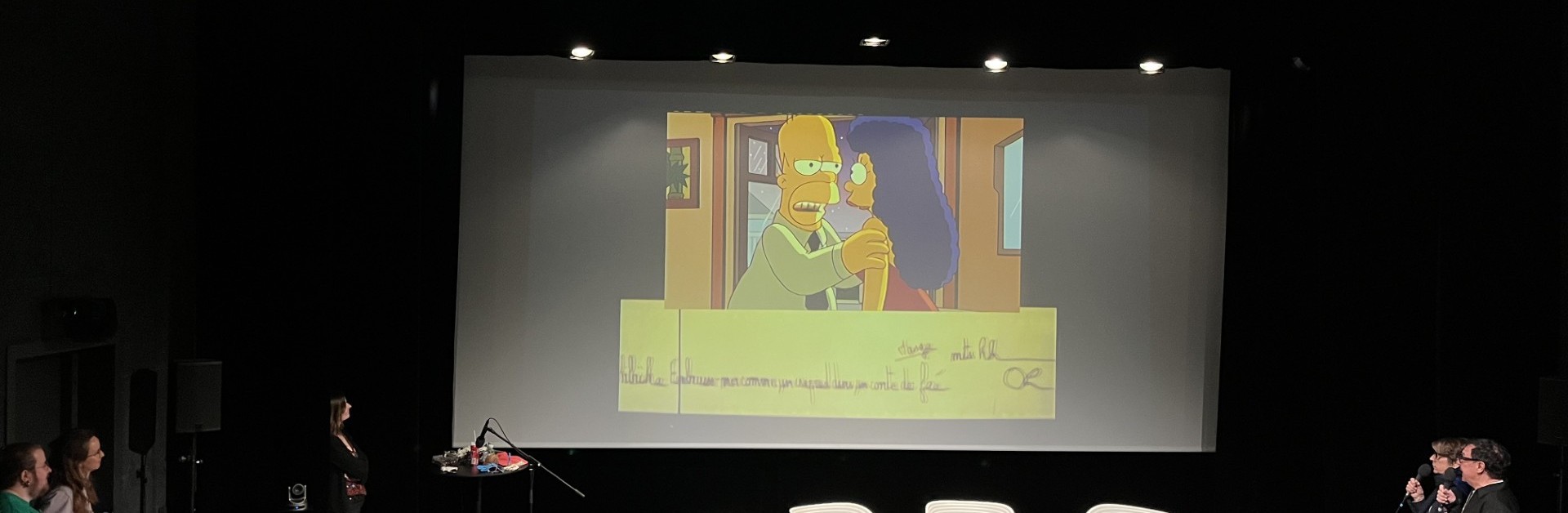
Rencontres du Lavoir
Publié le - Mis à jour le
Les Rencontres sont à la fois des émissions, des évènements et des moments d’échanges où le public croise entre autres artistes, auteur·e·s, chercheur·e·s, journalistes à l’occasion d’une soirée thématique.
Chaque rencontre est enregistrée sur place, puis disponible à emporter : en ligne et en podcasts !
La playlist Youtube de toutes nos RENCONTRES DU LAVOIR
Trop souvent, les médias véhiculent une image réductrice et stéréotypée de la banlieue, enfermant ses habitants et ses habitantes dans des clichés. La création audiovisuelle actuelle nous invite à changer de perspective. Des films, des podcasts, des web-séries et des initiatives numériques originales, à travers des jeux vidéo, la réalité virtuelle ou le métavers, repensent la représentation des banlieues. Ces œuvres racontent des histoires authentiques, explorent des futurs possibles et permettent à la population de se réapproprier son propre récit. Nos intervenants invités vous proposeront une autre vision des quartiers dits populaires ou périurbains et esquisseront de nouveaux horizons désirables.
Avec : Assia LABBAS, artiste, journaliste. Renaud EPSTEIN, Professeur de sociologie à Sciences Po St-Germain-en-Laye et auteur de "On est bien arrivés" (Nouvel Attila, 2021)
En dehors de la musique qui joue un rôle majeur dans l'univers sonore des films, les voix des personnages véhiculent leurs émotions et le bruitage contribue à rendre les images animées réalistes, même lorsqu'il s'agit de sons ou de voix qui n'existent pas dans la réalité.
Nos intervenants invités vont éclairer les étapes de création des voix et des sons et ce qui, en cinéma d'animation, donne le rythme entre l'image et le son. Ils préciseront la différence entre le doublage et la création de voix, et entre faire appel à une banque de sons et créer un bruit pour une image.
Avec les récentes évolutions technologiques, les pratiques vont être amenées à changer. Mais l'Intelligence Artificielle générative de voix sera-t-elle capable d'interprétations émotionnelles ? Et à l'avenir, le bruitage consistera-t-il à rédiger des prompts pour générer des sons ? Y a-t-il déjà un cadre juridique qui protège les artistes dans ces domaines ?
AVEC
Véronique Augereau et Philippe Peythieu, comédiens et notamment voix françaises de Marge et Homer Simpson
Claire André, bruiteuse
Les réseaux sociaux et Internet ont transformé notre culture du débat par les échanges d’idées et l’émergence d’une nouvelle parole publique. Les logiciels libres et l’ouverture des données publiques renforcent la transparence des informations et des processus de la vie politique.
A l’instar de la communauté virtuelle g0v (pour « gouvernement zéro ») qui s’est fait connaître lors de la mobilisation étudiante pro-démocratie des Tournesols à Taïwan en 2014 en utilisant la technologie pour permettre aux citoyens de participer plus activement à la vie politique, les civic tech (technologies à visée citoyenne) favorisent l’engagement citoyen en proposant des plateformes pour s’informer, débattre et agir.
Avec Fiorella Bourgeois, jeune chercheuse associée au Centre sur la Chine moderne et contemporaine (CECMC), UMR 8173 Chine, Corée Japon (EHESS-CNRS) et Ingénieure de recherche à l'Université Paris-Est Créteil (UPEC).
L'image dans le skate, c'est-à-dire la photo et la vidéo, est un aspect majeur de cette pratique née dans la rue dans les années 70.
Rythmée par une bande-son, l'image a façonné la culture skate.
Dans les années 80, les premières vidéos filmées en Super 8 sont en long format et visionnées par les aficionados sur cassettes VHS jusqu'à l'usure de la bande magnétique. Des cinéastes et des photographes s'intéressent ensuite à cette pratique urbaine et la font connaître à une plus large audience à travers des films de fiction, des documentaires, des photographies diffusées dans la presse spécialisée ou sur Internet. Aujourd'hui, YouTube et Instagram regorgent de clips vidéo de quinze secondes réalisées avec un smartphone.
Sur le plateau, skateurs, skateuses, filmeurs et filmeuses nous aideront à décrypter les codes esthétiques de la vidéo et de la photo de skate et à nous interroger sur l'influence des médias sociaux au sein de la communauté.
Interventions de:
Mélodie Cissou, réalisatrice et skateuse www.instagram.com/melodiecissou
Thomas Courteille, vidéaste et skateur www.instagram.com/stoopide
Réparer le corps, le dépasser en augmentant ses capacités physiques, ralentir le vieillissement, c’est déjà possible grâce aux NBIC (nanotechnologies, biologie, informatique et sciences cognitives).
Demain, pourrons-nous aussi transcender nos capacités intellectuelles grâce à une hybridation de l’humain avec la machine ? Apparier le cerveau humain avec une IA permettra-t-il de s’affranchir de notre enveloppe corporelle et faire perdurer notre existence au-delà de notre mort physique comme l’appellent de leurs vœux les transhumanistes ?
Aujourd’hui déjà, des deadbots, sortes de doubles numériques de personnes défuntes, parfois véritables avatars animés en 3D, offrent la possibilité d’un dialogue outre-tombe.
Mais qu’est-ce qui constitue l’identité post-mortem ? Est-ce simplement la trace figée de nos données en ligne orchestrée par des algorithmes ? Et ensuite, quel statut donner à ces représentations numériques désormais éternelles ? Sommes-nous prêts à vivre dans un monde virtuel peuplé de personnes décédées ?
Intervenant.e.s :
Fanny Georges, sémiologue, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’Université Sorbonne Nouvelle.
Nicolas Gutierrez C., journaliste scientifique. Il a publié en 2021 : Homo machinus, Enquête sur l’avenir de l’homme augmenté par la machine, Editions Vuibert.
Les arts sonores sont par nature un champ d'explorations transdisciplinaires, en connexion notamment avec les arts visuels. Se disant synesthète, le compositeur Alexandre Scriabine associait déjà intellectuellement sensations visuelles colorées et sensations auditives. Il en est ainsi de la couleur d'un son qui fait appel tout autant à ses propriétés physiques qu'à l'univers du rêve et de la poésie.
Les possibilités technologiques et numériques ouvrent la voie à des expérimentations et des détournements. Le transcodage modifie le signal d'une source audio ou vidéo. L'alchimie des ondes sonores, des images et des algorithmes, génère de façon contrôlée ou bien totalement aléatoire des formes multimédia performatives qui convoquent un nouvel imaginaire.
Mais c'est davantage le processus de création du son qui passionne les créateur·rice·s. Le son n’est pas tant une finalité qu’un objet de recherche, une matière à transformer et à restructurer. Et quand la générativité ou l’interactivité interviennent, les œuvres artistiques bousculent les sens : qu'est-ce qui est visible ? qu'est-ce qui est audible ?
Les Rencontres du Lavoir sont présentées par Sejla et Benoît.
Intervenant.e.s :
Federico Rodriguez-Jimenez, commissaire de l'exposition Visualiser le son / artiste sonore, pédagogue et musicien.
Sabina Covarrubias, compositrice, artiste multimédia et chercheuse en informatique musicale.
Notre quête d’informations pour comprendre le monde n’aura jamais été si facile pour les internautes et socionautes que nous sommes devenus.
Seulement les réseaux et la Toile sont surtout avides de sensationnel et de messages simplistes. Les algorithmes développés par les plates-formes, au service d’une économie qui cherche à capter notre attention, mettent ces contenus en avant et nous encouragent à les relayer : les sujets les plus populaires deviennent ainsi les plus partagés. Le phénomène est massif et se propage de façon virale, bien souvent sans questionnement.
Dans notre société dominée par l’image, photographies et vidéos sont présentées comme éléments de preuve et nous leur accordons sans peine un crédit aveugle.
Artistes, psychologues, sociologues et journalistes nous alertent. Ils nous invitent à exercer notre esprit critique face aux images manipulées et aux informations déformées ainsi qu’à prendre conscience des biais cognitifs auxquels a recours notre cerveau lorsque nous cherchons des informations renforçant un peu plus nos croyances.
Pour lutter contre les fake news et les thèses conspirationnistes, au-delà du debunking (ou démystification), l’éducation aux médias et à l’information est-elle suffisante pour décrypter la manière dont la fabrique du complot se met en place et agir ?
Intervenant.e.s :
Les Rencontres du Lavoir sont présentées par Sejla et Benoît, avec Yann Castanier, photojournaliste et membre de l’association Fake Off
Les Emojis, les GIFs, les mèmes, en tant que nouvelles formes de langage visuel, inondent les réseaux qui sont devenus des réceptacles de la culture geek, nourrie de pop culture, maniant avec art la réappropriation et le mix.
Les médias sociaux jouent désormais le rôle d’ateliers pour les artistes 2.0, véritables lieux de rencontres pluridisciplinaires où fl eurissent les reprises, les détournements, les collages… Ces créations numériques, qualifi ées de sous-culture par certain.e.s ou de nouvelles esthétiques par d’autres, viennent interroger le statut de l’oeuvre d’art, à l’image des NFT (jetons non fongibles), ces pièces virtuelles certifi ées uniques qui intriguent tout autant les collectionneurs que les spéculateurs.
Les Rencontres du Lavoir sont présentées par Sejla et Benoît avec les interventions de :
Nastasia HADJADJI, journaliste à L’ADN, productrice de l’émission de radio 'Music Herstory' et co-organisatrice du festival féministe 'Comme Nous Brûlons'
Anne HOREL, artiste digitale et polymorphe dont la rétrospective est exposée actuellement au Lavoir Numérique
La science-fiction explore les conséquences sociales des progrès scientifiques et technologiques. Elle nous montre un avenir possible, que l’on espère autant que l’on redoute ; un monde souvent sous haute-surveillance. Comme la littérature, le cinéma d’anticipation prépare-t-il nos esprits à ces scénarios, bien souvent dystopiques, dans lesquels l’oeil de l’intelligence artificielle interprète sans émotion nos moindres faits et gestes ou a-t-il pour rôle celui d’un lanceur d’alerte dans un monde où le rapport à la technologie est quotidien ?
INTERVENANTS :
Meera PERAMPALAM Chercheuse rattachée à l'Institut de Recherche sur le Cinéma et l'Audiovisuel (Sorbonne Nouvelle-Paris 3) et autrice d’une thèse de doctorat sur la surveillance dans le cinéma des années 1990 à nos jours.
Olivier TESQUET Journaliste d’investigation, spécialiste des questions numériques et des libertés publiques et auteur de plusieurs ouvrages, dont Etat d’urgence technologique (éditions Premier Parallèle) en 2021.
C'est un parcours à travers les étages, du studio son à la salle de projection en passant par les ateliers, qui a été proposé au public et aux invité.e.s de ces nouvelles Rencontres du Lavoir.
Performance musicale télématique, projection de films et vidéos YouTube, réalisation de podcasts et enfin un temps d'échanges autour de la thématique…. Le tout dans un cadre d'exposition : "Écrans partagés - La photographie après 31 ans de web" du collectif Diaph 8 jusqu'au 10 octobre 2021 au Lavoir Numérique.
En partenariat avec l'INA, Écran Sonore, Diaph8 et le collectif Jeune Cinéma.
Depuis plus de 30 ans, le web offre à la portée de tous, créateurs professionnels et amateurs, de nouvelles ressources, de nouveaux outils et de nouveaux procédés qui imposent désormais leurs propres codes. Entre croisement des pratiques et des disciplines, émergence de nouveaux formats et de nouvelles formes esthétiques,
cette émission fait une incursion dans le domaine de la création audiovisuelle née par et pour le web.
Intervenant.e.s :
Claire CHEVRIER, Photographe
Violeta CRUZ, Compositrice et artiste sonore
Gabriel LE BOMIN, Scénariste et réalisateur
Au commencement était le Net. Réseau des réseaux, il offre une formidable ouverture au monde en rendant possible les échanges internationaux en temps réel, en donnant accès à une quantité incommensurable de données produites quotidiennement. En cela, il crée ou donne l’illusion d’un accès aux savoirs universels. Il est à la fois vecteur d’une culture de la diffusion ou du partage et source de nouvelles formes collaboratives ou de solidarité.
Mais sa neutralité, l’un de ses principes fondateurs et garant de la liberté d’expression, est régulièrement menacée.
Intervenant.e.s :
Benjamin Thierry, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université Paris-Sorbonne.
Daniel Charnay, ingénieur de recherche CNRS.
Vi, membres de la Quadrature du Net.
Yaël Benayoun, co-fondatrice de l’association Le Mouton Numérique et co-autrice avec Irénée Regnauld de Technologies partout, démocratie nulle part (Fyp, 2020).
Thomas Courtial, directeur du développement numérique, Mission numérique EPT Grand-Orly Seine Bièvre.